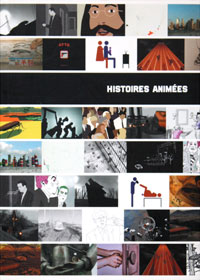Une vieille histoire indienne raconte qu’un homme, que les nécessités de la vie n’avaient pas fait souffrir plus que de raison, vint auprès d’un maître pour un enseignement. Hospitalité fut trouvée. Si le chemin pour arriver jusqu’à lui était tout aussi long qu’hasardeux, du moins il ne lui donna que plus de temps pour résoudre l’énigme du vieux sage. L’homme revint deux ou trois ans plus tard : « Juste ciel, j’ai travaillé nuits et jours et j’ai voyagé par-delà le monde pour percer votre énigme. Voilà, l’état de mon avancement. Je crois que ceci et cela… Son maître lui dit : « Te voici bien avancé » et l’invita à se promener au bord de la rivière. Là, il lui demanda d’entrer dans l’eau. Puis lui saisissant la tête, le maintint immergé jusqu’à la limite de l’évanouissement. Alors il lui dit : « Maintenant, je vais te donner une seconde chance : je te donne neuf ans pour y réfléchir avec autant d’énergie que tu as mis à te débattre. Après, tu reviens me voir ».
Neuf années s’écoulèrent quand l’homme revint voir son maître. Il le retrouva là où il l’avait quitté, sur les bords de la rivière. « Voilà, maître, neuf ans jour pour jour se sont écoulés, j’ai emprunté des sentiers familiers et des chemins de traverse, j’ai réfléchi, je ne suis plus le même, je suis arrivé au bout de mes forces. » Le maître lui répondit : « Maintenant, pendant neuf ans, tu l’oublies, puis tu reviens me voir ». Alors l’homme s’en alla, désespéré. Il revint neuf ans plus tard mais son maître était mort la veille. Il vit un disciple qui était près du défunt, un enfant, et il lui dit : « Je suis arrivé trop tard. Si seulement j’avais su. Tout cela pour rien, j’étais si prêt du but ». Et l’enfant lui répondit : « peut-être l’avais-tu trouvé depuis toujours, c’était le chemin… Le chemin que tu parcourais pour venir jusqu’à lui, le trajet que tu ne voyais même pas, tout occupé que tu étais d’arriver à temps… »
Ce cheminement nous apprend d’abord qu’il faut trouver son maître pour commencer à penser. Surtout, que la seule façon d’honorer ses rendez-vous, c’est-à-dire d’être à l’heure, c’est de savoir traverser la vie avec philosophie. En évaluant les distances. Car il faut du chemin à la pensée et chacun sait qu’arriver à l’heure ne peut se faire sans estime du trajet à accomplir. Ni estimation du risque encouru. En mourant sans prévenir, le vieil homme livre la clé de l’énigme : pour celui qui ne fait que passer, la ponctualité n’est pas de mise. Rien ne sert de presser le pas si c’est pour manquer le rendez-vous. Alors que le sage, lui, meurt comme il a vécu, immobile. Au fond de lui, il sait que quelque chose, dans la vie, ne se rattrape pas. C’est pourquoi, c’est au moment où il se laisse le plus distancer – quand le sage vint à mourir – que l’imbécile est au plus près du rendez-vous. Encore que c’est l’enfant qui le lui apprend. Or, qui sait ce qui s’enseigne, si ce n’est précisément d’apprendre à mourir. Le devancement vers la mort, c’est d’abord de vivre jusqu’à la mort, ce point de non-retour. Au diable l’agenda. C’est ce que dit l’enfant et qui se transmet de génération à génération : vouloir arriver à l’heure ne mène nulle part.
Chemin faisant, il vient en tête plein d’images plus ou moins justes. Celles des rendez-vous manqués. Des territoires parcourus. Des murs dressés. Des rencontres de fortune. Scènes d’amour et de guerre. Des disparus. Et tout ce temps perdu.
Éprouver un certain rapport au temps est essentiel à tous ces déplacements.
Je me souviens de toutes les fois où la lâcheté a pris le pas sur la ponctualité. Mea culpa. Tout ce chemin fait depuis.
Par-delà les débris et les regrets, inévitables, l’expérience du monde apprend à traverser la vie avec philosophie : à parcourir son propre espace intérieur plutôt qu’à courir le monde – depuis le tremblement des événements jusqu’aux approximations de la mémoire. L’image elle-même ne fait pas le monde, elle n’est qu’une ponctualité singulière et périssable. Mais c’est pour cela qu’il importe de la garder en mémoire.
Il n’y a pas d’image juste. Il n’y a que du flou, de l’image en basse résolution comme pour le bureau ovale de la Maison Blanche – bureau fantôme d’une maison hantée – dont Benoît Broisat restitue la spectrographie à partir d’images trouvées sur le Web. Comme si le réel – l’ici et le maintenant – était toujours doublé par le symbolique. Comme si la réalité d’une chose était toujours située en dehors d’elle-même, en faillite d’une adéquation de la chose et de sa représentation. Livré à toutes sortes d’occultismes, ce bureau ovale n’est pas seulement le rendez-vous des actualités internationales et le symbole du pouvoir, il porte le deuil de l’unique, de l’original. Toujours déjà mis en scène, le bureau ovale est livré à l’appropriation/expropriation : aux représentations les plus intimes et aux décentrements les plus improbables. Alors, comme tous les simulacres, sa morale est de penser le réel comme un théâtre dont la vocation est de devenir image. L’ironie est qu’il a été imaginé pour permettre au président américain d’avoir tout le monde à l’œil (cette mondialisation là est peut-être le seul crime qu’on ne peut accomplir qu’une seule fois).
S’il suffisait de voir, les choses seraient trop simples. Oval office (2007) montre qu’il n’y a pas d’image juste. Il n’y a que des faux-semblants. Et dieu sait si les simulacres sont nombreux. Il n’y a que de l’acclimatation. Dans les pixels, les fantômes. Seuls les fantômes se souviennent de la mort : l’horreur de la mort, c’est son apparence. Ces spectres en embuscade lient fidélité à la responsabilité : le bureau ovale est fait à notre image.
Rendez-vous est pris. Même lieu, même heure.
Proposer un lieu connu à des gens qui ne sont pas des inconnus redouble un désir de coïncidence, dans l’espace et dans le temps. Que fait-on lorsque l’on donne rendez-vous à quelqu’un, même lieu, même heure ? D’abord, on convient d’un délai qui équilibre la mémoire et l’au revoir par l’attente. De sorte que l’on puisse envisager un retour. Ici, on anticipe. Toute cette stratégie ne met certes pas à l’abri des retards ; du moins, elle réduit l’aléa de la prochaine rencontre par un choix continu. Même heure, même endroit se dit donc d’une fidélité portée en considération. Et cette fidélité, que seuls les vivants peuvent s’accorder entre eux, dit quelque chose d’une égale considération. Dans l’intervalle qui sépare un moment de son lendemain, elle rend possible le chemin et témoigne d’engagements réciproques. Puisse la ponctualité être au rendez-vous.
Après, au petit jeu des rendez-vous, qui me dit si le lieu et l’heure sont bien choisis ?
Car dans la vie, il y a toujours un tas d’accidents. De toutes sortes. On peut toujours espérer continuer d’exister jusqu’à la prochaine rencontre, rien n’est moins sur. La chance donnée à chacun doit se vivre à chaque heure comme s’il s’agissait de la dernière. La ponctualité ne sait pas presser le pas. Le savoir vivre se fait toujours en légèreté : le sérieux, c’est la surestimation du temps qu’il reste. L’accident, c’est ce qui arrive dans ce qui advient. C’est ce qui arrive sans cesse, à tous moments, en tous lieux et qui s’arrache à la continuité pour autant quelle soit quelconque. Il y a aussi des commencements dans le désastre. Or, quand bien même l’événement serait moins contingent que singulier, il ne serait pas pour autant transitoire. De Gaulle, que cite Althusser, avait cette formule magnifique, « l’avenir dure longtemps ». Car l’événement ne convoque pas l’avenir sans transformer d’abord la réalité du passé. D’où ce simulacre d’immobilité : les événements eux-mêmes ne se déplacent que très peu.
Dans 35 lieux du monde (2007), Carlos Castillo localise les grandes tragédies de l’histoire mondiale. Ce qui est jeté à terre, à même le sable, ce sont les cadavres de catastrophes dont il n’est plus que les coordonnées : tremblement de terre à Managua en 1972, répression militaire pendant la dictature de Somoza au Nicaragua, génocide, guerre civile... Au fond de la nef de la grange à dîmes, par une mer échevelée d’écume, Ece (2007), un tableau lui aussi un peu flou trahit le naufrage d’un transporteur dont l’océan garde jalousement le secret. En janvier 2006, 10 000 tonnes d’acide phosphorique se sont déversées dans la Manche. Ece figure le contenu invisible d’un bateau fantôme. Certainement, il y a de la concession dans cette installation et qui s’assimile à de la sépulture. Ces coordonnées sont autant de tombes : en elles, reposent les catastrophes. Mais il y a peut-être moins de concession que de prophétie, moins de désespoir que de résistance. Territoire 01 (2007) performe un espace qui ne serait que d’art et dont l’Abbaye de Maubuisson serait le porte-drapeau, hic et nunc. Vocation. Exorcisme pour que la catastrophe ne soit plus un lieu commun. L’appel à responsabilité est toujours la faveur du désastre.
Les hommes qui ont vécu savent qu’il n’est pas simple de vivre. Vivre, c’est accepter d’être affecté, si ce n’est d’être en difficulté. Quand ce n’est pas la force du préjugé qui les en empêche, la propagande, le mensonge et toutes sortes de cynisme s’occupent de transformer les faits en opinion. En revanche, ceux que la lâcheté ne fait pas fuir savent qu’il ne suffit pas de voir une image pour la vivre : il faut savoir la rendre.
La tragédie, c’est qu’on ne peut pas faire autrement que, chaque jour, oublier. C’est le lot des vivants. L’oubli qui accompagne tout savoir tient en vie. Seuls les fantômes se souviennent de la mort.
Tombe pour Anna Politovskaïa (2007) de Pascal Convert rend hommage à la journaliste russe assassinée le 7 octobre 2006. « Des mots peuvent sauver des vies », disait-elle : pour cette conviction, pour avoir dénoncé tant de crimes commis en Tchétchénie et rendu la parole aux victimes, Anna Politovskaïa a perdu sa vie. Symboles d’une confrontation déchirante, un piano silencieux et une souche arrachée à la terre de Verdun accompagnent une stèle de verre. L’art est un mémorial, puisse t-il soulager les âmes en peine car il n’est pas simple d’enterrer les morts. Il n’y a pas d’appel à la justice sans responsabilité du présent. Avec ce paradoxe terrible : on n’empêche pas le dernier crime, mais on peut le prévoir. Ce qu’on ne peut pas prévoir en revanche, c’est le prochain. « Today’s news is tomorrow’s war » annonce la vidéo de Grace Ndiritu, Desert Storm. Le prix de la vérité, c’est la mort. Fin de l’innocence.
En démocratie comme en dictature, l’art n’éprouve pas le réel sans se mettre lui-même en danger de mort.
Il n’y a pas d’image juste, disais-je. Il n’y a que des requiems. Des prières (Grace Ndiritu, Time, 2004). Des larmes. Des appels à la justice. Des transes funèbres. Convoquer les morts, sans défi de pardon, est encore le meilleur moyen de s’adresser aux vivants.
D’où la position médiane de l’artiste qui n’est ni un journaliste ni un documentariste, mais un chaman. Depuis le fond des âges, il est le guérisseur blessé qui danse au rythme du monde, qui incarne les souffles, les convulsions et qui guète les symptômes de l’existence. Somnambule dont le corps est le temps d’une hypnose, son art travaille le monde au corps. Le monde, comme la magie, s’étend à l’infini. Je crois que c’est Hegel qui parlait de la magie la plus primitive comme l’origine permanente des événements. Dans ce tremblement des apparences, surgit la grande scène des combats infiniment répétés entre la mort et la naissance (Grace Ndiritu, Absolut Native, 2003), le jour et la nuit, l’espace et le temps, le passé et le présent, l’ici et l’ailleurs, la voix et l’image, l’homme et le monde… À la fin de la transe, le corps s’essouffle. Le regard ferme les yeux pour l’éternité. Le chaman n’a plus lieu. Il n’y a pas de danse qui ne parle pas de mort ni de liberté. De cet épuisement extatique dont témoignent les tempêtes du désert (Desert Storm, 2004) surgissent, anachroniques, analphabètes, les images des morts. La mort dans les yeux, l’artiste ouvre la porte à toutes sortes de fantômes.
Doors (2004-2007), le dispositif d’Olga Kisseleva, réunit sur les faces d’un même écran deux mondes que tout sépare. Dans une ruelle d’un village afghan, des hommes boivent du thé. Une porte s’ouvre. De l’autre côté, des dirigeants européens entrent dans un bâtiment administratif. Les images se font scènes, ambivalentes. Olga Kisseleva montre qu’il n’y a pas de frontières qui ne soient déjà franchies (Border, no border, 2005-2007). Que le sens, comme l’existence, est fragile, provisoire. Qu’il n’y a rien à la fois de plus simple et de plus difficile que de croiser les mondes. Mais sans doute est-ce là la condition, pour l’image, d’être vivante : d’être comme une afghane en Corse, ainsi que le suggère poétiquement Seulgi Lee.
Il y a dans Une afghane en Corse (2001), une image discrètement reliée à Direct indirect III, cauchemars (2004) de Pascal Convert. Elle montre l’artiste cagoulée d’un tissu à fleurs, adossée à la boite postale d’un petit village corse. Peut-être vient-elle de poster une quelconque carte postale ? Adressée à dieu sait qui. Ou peut-être nous montre t-elle que quelque chose ne peut se destiner qu’en s’affranchissant ? Qui sait ce qui arrive dans ce qui se destine. L’artiste sud-coréenne déambule ainsi sur l’île de beauté. Ce chiffon fleuri est-il l’image de ce qui s’encagoule sur cette île ou le souvenir d’une burqha en pays afghan ? Revendication indépendantiste ou violence faite à la femme ?
Un enfant debout au côté du cadavre de son grand-père est perdu dans le désastre qui surgit. Il hurle de toutes ses forces ce que son grand-père lui faisait apprendre par cœur : son adresse. Son lieu de vie, sa demeure. Face à la mort, seuls les liens généalogiques peuvent nous maintenir en vie et nous retenir dans le monde des vivants, par delà le spectre de l’oubli. Comme si on était proche de sa vérité qu’au moment de sauver sa propre vie.
Vous savez pourquoi ? Parce qu’on n’est jamais à l’abri d’une catastrophe ; du moins, ce risque n’a-t-il jamais empêché personne d’habiter le monde.
Je dis toujours qu’il y a plein d’images qui viennent à l’esprit.
Que l’avenir dure longtemps.
Qu’il n’y a pas de murs qui ne peuvent être abattus.
Que les illusions ne dispensent pas de regarder les choses en face.
Que la morale exige que nous nous mettions en péril aux moments précis de notre ignorance.
Que la responsabilité est irrécusable.
Que vivre est une chance d’être ému.
Et que la vie est faite de traverser des émotions.
Que moi qui parle de la mort des autres, je vais mourir.
Qu’à cet instant, rien en moi ne parlera plus.
Que seuls les endeuillés seront consolés.
Mais qu’en attendant, plusieurs futurs sont possibles, et encore davantage de retours.
Enfin, que même si rendez-vous est pris – même heure, même endroit – il y aura toujours mille et une ruses pour ajourner ponctualité, ne serait-ce que par ce que l’image est toujours un espace où se perdre.
Bibliographie :
Louis Althusser, L’avenir dure longtemps suivi de Les faits, Paris, Stock / IMEC, 1992, 2007.
Mouvement, La responsabilité du présent, N°43, avril-juin 2007.
Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort suivi de Fragments, Paris, Seuil, 2007.
Avital Ronell, American philo, Paris, Stock, 2006.
An old Indian tale recounts that a man who had not suffered unduly from the demands of life came to a master to receive instruction. He encountered hospitality. Though the path he had travelled to get there had been long and hazardous, it would at least give him all the more time to solve the wise man’s enigma. The man returned two or three years later: “Heavens above! I have worked night and day and travelled the world to reveal the secret of your enigma. Here is the state of my progress. I think this and that…” His master said: “Some progress!” and invited him to take a walk beside the river. There he asked him to get in the water, whereupon he grabbed his head and held him underwater until the man was close to blacking out. Then he said: “Now I am going to give you a second chance: I’ll give you nine years to think about it, putting as much energy into it as you did to fight in the water. Come back and see me after that.”
Nine years had passed when the man came back to see his master. He found him where he had left him, on the banks of the river. “Well master, nine years have passed to the day, I have taken familiar paths and unknown crosscuts, I have thought long and hard, I am not the same man, I am at the end of my tether.” The master replied: “Now go and forget about it for nine years, then come back and see me again.” So off the man went, in despair. He came back nine years later but his master had died just the day beforehand. He saw a disciple standing near the body, a child, and said to him: “I got here too late. If only I had known! It was all for nothing, and I was so close to my goal.” The child replied: “Maybe you found it long ago. It was the path… the path you took to see the master, the journey you couldn’t even see because you were so busy arriving on time…”
The first thing this teaches us is that in order to start thinking you have to find your master. And above all, the only way to keep your appointments, i.e., to be on time, is to know how to go through life philosophically. Evaluating the distances. Thought needs to make its own progress and everyone knows you cannot be on time without gauging the path to be travelled. Or the risks incurred. By dying without warning, the old man delivered the key to the enigma: to he who is just passing, punctuality is incongruous. There is no point hurrying up if you’re going to miss the appointment. The wise man dies as he lived, immobile. Deep down he knew that something in life cannot be recovered. This is why the fool is closest to his appointment when he lets himself be most left behind, i.e., when the wise man dies. Though it is the child who lets him know it. Who knows what is being taught, apart from learning how to die. Death ahead of time is firstly living until death, the point of no return. To hell with the schedule. This is what the child says and this is what is passed on from generation to generation: wanting to arrive on time gets you nowhere.
On the way, a host of more or less accurate images come to mind. Missed appointments. Territories crossed. Walls raised. Chance encounters. Scenes of love and war. People gone missing. So much time lost.
To make these travels, you must have a certain relationship with time.
I remember all the times when cowardice overrode punctuality. Mea culpa. What a way I have come since.
Beyond the rubble and inevitable regrets, experiencing the world teaches you to go through life philosophically: to cross your own inner space rather than roam the world, from the quake of events to memory’s approximations. The image itself does not make the world, it is merely a special, perishable punctuality. But this is why it is important to keep it in your memory.
There are no accurate images. Merely hazy, low resolution images, like for the Oval Office in the White House—the ghost office of a haunted house—which Benoit Broisat recreates spectographically using images found on the Internet. As though the real—the here and now—was always overtaken by the symbolic. As though the reality of a thing was always located outside it, the failure to match it up to its representation. Left to all kinds of occultisms, this Oval Office is not just an appointment with international news and the symbol of power, it mourns the unique, the original. The Oval Office, which is always seen ready-staged, is given over to appropriation/expropriation: represented most intimately and thrown most improbably off centre. Like all simulacra, its moral is to think of reality as a theatre whose vocation is to become image. The irony being that it was designed so that the American President could have his eye on everyone (this globalisation is perhaps the sole crime that can only be accomplished once).
If seeing sufficed, things would be too simple. Oval office (2007) shows there are no accurate images. Only pretences, and Lord knows how many simulacra. Only acclimatisation, in the pixels, the ghosts. Only ghosts remember death: the horror of death is its appearance. These phantoms lurking in ambush become loyal to responsibility: the Oval Office is made in our image.
An appointment is made. Same place, same time.
Proposing a familiar place to people who know each other heightens a desire for coincidence in space and time. What do you do when you make a date with someone: same place, same time ? First you agree on a time span that balances memory and parting by looking forward. Envisaging a return. Here, you anticipate. This strategy doesn’t get rid of lateness, but in choosing continuity it does reduce the uncertainty of the next meeting. Same time, same place is thus said of a loyalty taken into consideration. And this loyalty, which only the living can grant each other, says something of equal consideration: it allows for a path in the interval between one moment and the next and is a testimony to reciprocal commitments. May punctuality be appointed too.
Afterwards, in the little game of dates, who says the right place and time have been chosen ?
For life is full of accidents of all kinds. We always hope we will carry on existing until the next meeting, but nothing could be less certain. The chance that each person is given must be lived out each hour as if it was the last. Punctuality does not know how to quicken the pace. Social etiquette is always light-hearted: what’s serious is overestimating the time that is left. Accidents are what happens to befall. What keeps on happening, any time, any place, wresting events from bland continuity. Beginnings can occur in disaster too. While the event can be more particular than contingent, this does not necessarily make it transitory. De Gaulle, quoting Althusser, put it famously, “the future lasts a long time”. For the event does not convoke the future without first transforming the reality of the past. Hence the simulacrum of immobility: events themselves very rarely travel.
In 35 lieux du monde (2007), Carlos Castillo locates the major tragedies of world history. What is thrown down in the sand are the corpses of catastrophes, for which the work forms merely the coordinates: earthquake in Managua in 1972, military repression during the Somoza dictatorship in Nicaragua, genocide, civil war… At the end of the tithe barn nave, in a frenzied sea of foam, Ece (2007), a painting that is also slightly hazy, reveals the sinking of a tanker which the ocean is very much keeping to itself. In January 2006, 10,000 tonnes of phosphoric acid were spilled into the Channel. Ece represents the invisible contents of a ghost ship. There is certainly concession in this installation that likens itself to a grave. These coordinates are so many tombs: here lie catastrophes. But there is perhaps more prophecy than concession, more resistance than despair. Territoire 01 (2007) perforates a space that may only be art and for which Maubuisson Abbey would be the flag-bearer, hic et nunc. Vocation. Exorcism so that catastrophe will no longer be commonplace. A call for responsibility is always down to disaster.
Men who have lived know that living is not simple. Living means agreeing to be affected, or else in difficulty. Propaganda, lies and all manner of cynicisms take care of turning facts into opinions, when strength of prejudice does not stop them. But those who do not flee in cowardice know that seeing an image is not enough to live it: you have to know how to render it.
The tragedy is that day after day we cannot help but forget. This is the lot of the living. The oblivion that goes with all knowledge keeps us alive. Only ghosts remember death.
Pascal Convert’s Tombe pour Anna Politkovskaïa (2007) pays tribute to the Russian journalist assassinated on 7 October 2006. “Words can save lives”, Anna Politkovskaya used to say: she lost her life for this conviction, for denouncing the numerous crimes committed in Chechnya and giving victims a voice. Symbols of a heart-rending confrontation, a silent piano and a tree stump ripped from Verdun soil accompany a glass stele. Art is a memorial, let us hope it can soothe lost souls, for it is not easy to bury your dead. There is no call for justice without the responsibility of the present. And with this terrible paradox: you do not prevent the last crime, but you can expect it. What you cannot expect, however, is the next one. “Today’s news is tomorrow’s war”, announces Grace Ndiritu’s video, Desert Storm. The price of truth is death. The end of innocence.
In democracies as in dictatorships, art does not experience reality without risking death.
There are no accurate images, I was saying. Just requiems. Prayers (Grace Ndiritu, Time, 2004). Tears. Calls for justice. Funeral trances. Summoning the dead, without the challenge of pardon, is still the best way to address the living.
Hence the median position of the artist, who is not a journalist or a researcher, but a shaman. Since the dawn of time he has been the wounded healer dancing to the rhythm of the world, embodying breath and convulsions, looking out for the symptoms of existence. A sleepwalker whose body is a spell of hypnosis, his art puts pressure on the world. The world, like magic, stretches to infinity. I think it is Hegel who spoke of the most primitive magic as the permanent origin of events. In this trembling of appearances looms the scene of endlessly recurring fights between birth and death (Grace Ndiritu, Absolut Native, 2003), day and night, space and time, past and present, here and there, voice and image, man and the world… When the trance is over, the body is breathless. The gaze closes its eyes for eternity. The shaman is gone. There is no dance that does not talk of death or freedom. Anachronistic, illiterate images of the dead rise up from this ecstatic exhaustion witnessed by desert storms (Desert Storm, 2004). With deathly eyes, the artist opens the door to all kinds of ghosts.
Doors (2004-2007), Olga Kisseleva’s installation, brings together on one screen two worlds that could not be further apart. Men drink tea in an Afghan village backstreet. A door opens. On the other side, European leaders enter an administrative building. The images become ambivalent scenes. Olga Kisseleva is showing that all borders have been crossed (Border, no border, 2005-2007), that meaning, like existence, is fragile and temporary, that nothing is as simple yet as difficult as bringing worlds together. Yet for images this is no doubt the condition of being alive: to be like an Afghan woman in Corsica, as Seulgi Lee poetically suggests.
There is an image in Une afghane en Corse (2001) that is discreetly linked to Pascal Convert’s Direct indirect III, cauchemars (2004). It shows the artist in a balaclava made of flowery material, leaning against a post box in a small Corsican village. Perhaps she has just posted a postcard ? Addressed to God only knows who. Or perhaps she is showing us that something cannot be destined without being stamped ? Who knows what goes on in what is destined. The South-Korean artist strolls around the Isle of Beauty in this way. Is this flowery cloth the image of what is hooded on this island or the memory of a burqa in Afghanistan ? A separatist statement or a violence against women ?
A child standing beside the body of his grandfather is lost in the disaster that has struck. He yells at the top of his voice what his grandfather made him learn by heart: his address. The place where he lives, his home. In death, only genealogical links can keep us alive in the world of the living, far from the ghosts of oblivion. As though we only come close to the truth of it the moment we save our own lives.
Do you know why ? Because you’re never safe from catastrophe; but this risk has never stopped anyone from inhabiting the world.
I always say that many images come to mind.
That the future lasts a long time.
That there are no walls that cannot be pulled down.
That illusions do not exempt you from facing facts.
That morality demands that we jeopardise ourselves at the very moments of our ignorance.
That responsibility is undeniable.
That living is a chance for emotion
And that life is made for undergoing emotions.
That I who talk of other people’s deaths, am going to die.
And at that moment, nothing in me will speak again.
That only the grievers will be consoled.
But in the meantime, several futures are possible, and even more reversals.
Finally, that even if an appointment is made—same time, same place—there will always be a thousand and one excuses for postponing punctuality, if only because the image is always a space to get lost in.
Bibliography:
Louis Althusser, L’avenir dure longtemps, followed by Les faits, Paris, Stock / IMEC, 1992, 2007.
Mouvement, La responsabilité du présent, n° 43, April-June 2007.
Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, followed by Fragments, Paris, Seuil, 2007.
Avital Ronell, American philo, Paris, Stock, 2006.